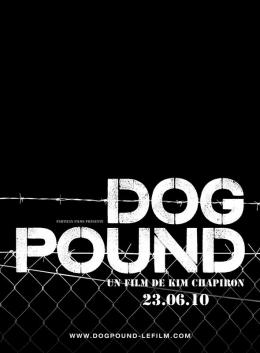L’homme sans passé, Aki Kaurismäki.
 A peine arrivé à Helsinki par un train de nuit, un homme est battu à mort par trois individus alors qu’il s’est endormi sur un banc public. Déclaré mort, et pourtant toujours vivant mais profondément amnésique, il tente de se construire une vie avec l’aide des SDF qui l’ont recueilli ; sans identité il doit également faire face aux difficultés d’exister auprès de l’administration.
A peine arrivé à Helsinki par un train de nuit, un homme est battu à mort par trois individus alors qu’il s’est endormi sur un banc public. Déclaré mort, et pourtant toujours vivant mais profondément amnésique, il tente de se construire une vie avec l’aide des SDF qui l’ont recueilli ; sans identité il doit également faire face aux difficultés d’exister auprès de l’administration.D’une trame apparemment bien simple, celle d’un homme renaissant dans l’amnésie, le film de Kaurismäki est pourtant d’une retenue touchante et d’un comique troublant. Car loin des standards émotionnels où les larmes sont de mises pour toucher, et les gags et quiproquos assumés nécessaires à l’amusement du spectateur, L’homme sans passé effleure l’émotion, le sentiment, sans jamais l’appuyer. Les attitudes des personnages qui pourraient, au premier abord, sembler n’être que froideur pour un public peu habitué à ce type de cinéma, s’avère finalement être une sorte de timidité sensible, humble, attachante où les paroles sont versées au compte-goutte, comme si seul l’essentiel était prononcé.
Le comique quant à lui, est omniprésent dans le film, comme une bouée de secours aux difficultés et quelque part aussi, à un certain pessimisme sur la complexité d’exister socialement quand on est sans-abris et sans identité. L’homme sans passé s’appuie sur un comique parfois presque « cartoonesque » : il n’y a qu’a voir la façon exagérée et accompagnée d’un bruitage lorsque le personnage principal ( Lujanen ) remet son nez en place avant de partir de l’hôpital, ou encore la scène dans laquelle, amorphe, il se fait voler ses chaussures par un SDF. De même que ces silences infinis qui ponctuent les dialogues, qui soulignent comme une gêne, de ne savoir que faire ( les rendez-vous avec Irma ) ou que dire, qui être, absurdement ( la scène de l’ANPE ). Notre rire est simple, comme le sont les scènes.
C’est grâce à ce comique que la gravité de l’histoire de cet homme devient seulement latente dans le film, presque secondaire. L’histoire vraie, celle qui prime, reste celle d’une renaissance ; peut-être même d’une naissance à une quarantaine d’années, dans un univers nouveau, quasiment un hors-temps. On ne peut, en tant que spectateur, que s’attacher à quelqu’un que l’on voit grandir, car oui, il grandit : de la becquée à l’émancipation en passant par un « premier » amour, un apprentissage de la vie dans un lieu marginalisé, celui du terrain vague où vivent en communauté les pauvres d’Helsinki, ces gens qui, comme Lujanen, n’existent presque pas aux yeux de l’Etat.
Et c’est finalement dans cet espace, au milieu de ce groupe d’individus, que la vie semble la plus paisible, où il fait bon vivre. Car eux aussi sont drôles et attachants, grands d’une générosité et d’une compréhension qui ne semblent nullement exister dans l’économie et l’industrie de la ville. De la pauvreté de ces gens et de ce paysage de containers transformés en habitats précaires, émerge une beauté pleine de solidarité, d’autogestion, d’entre- aide et de musique : une richesse ? Certainement. La vie en un sens ne semble pas difficile, le linge étendu sèche devant un ciel bleu azur, on se lave dans un bidon avec de l’eau chauffée versée par un membre de sa famille, on joue de la musique, le temps est beau comme le climat est chaleureux, et le vendredi, on va manger la soupe de l’Armée du Salut comme on irait au restaurant. Même le vigile qui semble un être violent, près de ses sous, est en fait un homme plein d’humanité. Hors des conventions imposées par la société donc, se trouvent des valeurs sans aucun doute bien plus importantes, honorables, et surtout humaines que celles soutenues par la ville.
Cette beauté n’est pas sans rapport avec la photo, douce, les aspects orangés des lampes la nuit et les couleurs vives des containers délabrés qui contrastent avec la grisaille des murs de la ville, de ceux de la banque, du froid de l’ANPE. Les institutions, tout comme ceux qui la composent sont laids et peu avenants face à la candeur de l’homme neuf et perdu que se trouve être Lujanen. C’est ce contraste qui fait une partie de la réussite du film de Kaurismäki en ce sens qu’il nous amène, nous, spectateur, à voir avec plus d’ébahissement encore le monde dans lequel nous évoluons, à travers le parcours d’un homme au regard novice que nous suivons avec notre expérience ; ce passé que Lujanen n’a plus.
C’est après une séquence absurde du hold-up d’une banque par un homme désespéré, qui conduit Lujanen en garde à vue, puis à la découverte, enfin, de son ancienne identité, qu’il va renier le monde auquel il n’appartient plus, pour rentrer « à la maison », là où il se sent bien : là où il est né, dans cette … « presqu’utopie sociale » à laquelle on aurait bien envie de participer.